En ce qui me concerne, fin juin 1950, j’avais été débarqué du D.E Marocain sur lequel j’étais en subsistance après avoir quitté l’Émile
BERTIN.
Une barcasse « nous » a transportés (mon sac et moi), jusqu’au LEITA, à l’ancre dans la rade de TOULON.
La topographie du « Landing Ship, Tank » LST LEITA, m’était alors inconnue, c’était un bâtiment de débarquement de chars, ce navire avait été construit pour les opérations amphibies et son type créé durant la Seconde Guerre mondiale pour débarquer des véhicules lourds sur des lieux non préparés, comme des plages.
Selon les sources 1 051 de ces navires furent conçus à partir de 1940, construits par les chantiers navals alliés et ils furent utilisés pour les opérations de débarquement en Europe et dans le Pacifique, 37 furent perdus par l’US Navy pendant la guerre.
Pour mieux comprendre ce que fut notre voyage voici, pour mémoire, les caractéristiques du LST La LEITA
Construit à Evansville (USA) en 1943, il fut transféré à la France en 1947.
Déplacement : 1625t
Longueur : 99,97m
Largeur : 15,24m
Tirant d’eau : 4,3m
Numéro de coque : L9001
Date admission au service actif : 22/06/1943 USA, 13/03/1947 transfert
Date retrait service actif : 31/07/1964
Date mise sur cale : 05/02/1943
Date lancement : 16/05/1943
Nombre d’officiers : 5
Nombre d’officiers mariniers : 67 OM QMM
Propulsion : 2 diesels
2 hélices
1800cv
Système de combat : 2x40mm
4x20mm
Distance franchissable : 6000 M à 9 nd
Vitesse maximale : 12 nd

Quelle était la distance entre TOULON et PHILADELPHIE ?
A vue de nez, comme les chiens attrapent les puces, autour 5000 nautiques ?
Selon mes souvenirs (chancelants) nous avons mis 24 jours ce qui était compatible avec les conditions de temps rencontrées et le fait que de TOULON le LST n’étant pas un oiseau on sort d’abord de la Méditerranée par GIBRALTAR avant de prendre le bon cap ce qui (à vitesse constante et théorique de 216 miles par jour) représenterait un trajet d’environ 5 200 nautiques.
Voici le témoignage que notre Ami COUTIL a déposé :
« Étant au dépôt de Toulon un gars me dit va voir tu as ton nom sur une affiche,
J’y suis allé, et, à la joie, je devais embarquer sur la LaÏta LST pour les States.
Nous embarquons mais que de monde 2 équipages pour 2 destroyers plus plusieurs équipages pour San Diégo.
A bord il y avait des chaînes en travers supportant beaucoup de hamacs.
pas de changement avec le dépôt de Toulon, mais ce qui a changé c’était la nourriture dans des plateaux, finies les gamelles pleines de graisse du dépôt.
Le plus amusant c’était les poulaines le long de la coque une vingtaine de chaque côtés
ça pouvait aller mais ce qui n’allait plus quand nous avons dépassés Gibraltar grosse tempête les officiers ont annoncés nous sommes obliger de descendre le long de l’Afrique le bateau risque de se casser alors après c’était le roulis quel sport pour aller aux poulaines ça bougeait tellement que les gars montaient manger sur le pont avec leur plateau et l’on voyait plein de petits papiers voltiger je vous laisse deviner d’où cela venait (bon appétit) ensuite cela s’est apaisé.
Arrivés à l’embouchure du Delaware, accosté par un bateau américain sanitaire ils nous ont fait entrer dans une petite pièce sur le côté du LST et nous ont bombardés à la DDT.
Le LST a accosté à Philadelphie après c’était la vie de château, grosse nourriture à la cafète avec orchestre, mais plus de corvées et voilà.
Je pense que plusieurs de vous y sont passés.
Amitiés à tous.
Claude Coutil,
Je raccroche, derrière lui, mes propres souvenirs :
Embarqués sur la LEITA, nous nous sommes retrouvés, à peu près à 300 hommes, dans le «second deck» qui avait été équipé de bannettes superposées par 5 en hauteur afin de nous recevoir tous.
Ce deck était un immense hangar qui occupait au moins les 8/10 de la longueur de la LEITA, les 2/10 restants à l’arrière étant occupé par le poste d’équipage.
C’était un bricolage fait d’une structure de tubes d’échafaudage ; à chacun des niveaux horizontaux, on avait enfilé sur les 2 tubes latéraux des toiles à hamacs contenant un « matelas » d’une épaisseur initiale de 2 centimètres, et basta.
En bas de cette construction on se sentait submergé par la forêt de tubes et de toile environnante masquant toute autre visibilité.
Afin de m’en extraire je suis aussitôt allé installer mon « baise-en-ville » sur la couchette la plus haute qui était à ma portée afin d’avoir une visibilité à 360° sur le plafond et les parois du deck.
Ce faisant, les choses se passaient dans l’euphorie de ce que représentait, en 1950, dans cet après-guerre, la perspective d’un voyage vers le continent Américain.
Nous avions le sentiment, à cette époque qui suivait un conflit mondial, l’occupation allemande et le confinement qui allait avec, les privations dans tous les domaines, que nous allions, enfin, découvrir un autre monde.
En haut, sur le pont dit « Main Deck », comme le dit si bien COUTIL, il y avait une série d’édicules sommaires, en bois, accrochés en saillie, et qui étaient en matière de chiottes des W.C à la turque, sans chasse d’eau évidemment, les déjections allant directement tomber au mieux dans la mer, au pire se coller à la coque si le roulis et la coïncidence du vent relatif, appliquaient la règle du fil à plomb.
Le pire, à l’usage, que l’on dit pour les optimistes ne pas être toujours certain, c’était à l’évidence la trajectoire prise par les papiers dits AQ.
Ceux-ci, dès leur sortie du rustique édifice, s’envolaient, emportés par la turbulence aérodynamique due au déplacement du navire.
Ces feuilles, qui n’avaient rien d’hygiénique, suivaient une courbe ascendante et Intéressante à observer.
Elle les amenait souvent à se plaquer sur la face du « Deck House », ou pire, d’aller survoler la passerelle ouverte, obligeant ses occupants à être vigilants et de baisser la tête au bon moment…
Bonne et saine distractions, bien sûr, pour les amateurs de plein air que nous sommes rapidement devenus.
Avant de parler de la pluie et du beau temps rencontrés, et pour en rester au confort hôtelier, il faut dire qu’arrivés à la hauteur de Gibraltar l’eau douce a été réservée à la consommation alimentaire.
Conséquence : de l’eau de mer au bout d’un tuyau souple pour une douche froide sur le pont, ou variante, aller à l’avant faire la queue le leu, arriver devant 2 infirmiers assis sur leurs chaises, enlever sa vareuse, lever un bras puis l’autre afin de recevoir sous les aisselles une giclée de DDT.
Et pour finir la désinfection et achever de perdre sa dignité, déboutonner le pont de son pantalon, le rabattre, puis baisser le slip afin de recevoir sur les bijoux de famille une dose généreuse destinée à dénicher et à exterminer les éventuels morpions qui, chaleur et humidité aidante, commençaient à proliférer dans les bannettes.
Il y eut aussi les passages à l’infirmerie afin que soient détectés les éventuels symptômes d’une MST.
Une goutte au bout du zizi entraînait un prélèvement, suivi de jours de doutes et de méditations transcendantales dans l’attente des résultats…
Qu’il fallait aller humblement solliciter et qui se sont révélés le plus souvent négatifs.
Dans les conditions de navigation évoquées par l’Ami COUTIL, il faut dire que dans la fosse du « main deck », où il faisait si chaud en ce mois de juillet 50, sur notre lit douillet, l’on ne dormait qu’en caleçon et en transpirant comme des malades.
Pendant les nuits ou la barque roulait et tanguait, agrippé à mon perchoir je voyais passer le Commandant en second, muni d’une torche, examinant les flancs de notre cuve (qui commençait sérieusement à puer le renard), à la recherche d’une fissure éventuelle.
Ces passages généraient en pleine nuit des conversations sur les rituels du naufrage, et chez nos Bretons des histoires de rongeurs domestiques à longues oreilles dont il mal séant et dangereux de citer ici, encore, le nom.
La majorité des 300 passagers que nous étions s’apprêtaient à traverser les États Unis pour se rendre sur la côte ouest y armer des bateaux qui devaient ensuite s’acheminer en Indochine, la minorité à laquelle COUTIL et moi appartenions devait constituer les équipages des 2 Destroyers d’Escortes que nous allions chercher.
Pendant les 24 jours que dura cette traversée, on a eu le temps de parler…
Et de refaire le monde, nous étions impatients de voir se concrétiser cette Amérique mythique, dont à l’époque nous n’imaginions pas encore la puissance et la richesse, en la comparant avec notre pauvre FRANCE d’alors, si éprouvée par la Seconde Guerre mondiale.
Il y avait aussi la mer à contempler (sans chaise longue), de jour, de nuit, par beau et mauvais temps.
À un moment, quand nous avons traversé la mer des sargasses, par un temps fort calme, la chaleur rendant le sommeil impossible, je suis monté sur le pont, à bâbord avant, et appuyé au bastingage, là ou de jour je venais voir les dauphins nous accompagner et les exocets, ces poissons qui sortent de l’eau, faire des vols d’une quarantaine de mètres.
Cette nuit-là, sous un ciel profond, à la voûte pleine d’étoiles, la vague d’étrave était phosphorescente, c’était magique.
Et je pensais à mes lectures d’adolescent, à ces quelques livres délabrés de l’armoire de notre salle de classe, qui étaient pendant la guerre le seul moyen, mais puissant, de rêver d’un ailleurs.
À Jules VERNE en particulier, dont je propose un extrait de « 20 000 lieues sous les mers – à propos de la Mer des Sargasses.
[i]« Au milieu de cet inextricable tissu d’herbes et de fucus, je remarquai de charmants alcyons stellés aux couleurs roses, des actinies qui laissaient traîner leur longue chevelure de tentacules, des méduses vertes, rouges, bleues, et particulièrement ces grandes rhizostomes de Cuvier, dont l’ombrelle bleuâtre est bordée d’un feston violet. »
Ces quelques lignes m’avaient traumatisé, comme tous les gamins auquel on fait la démonstration de leur ignorance du français, de leur inculture et de la tragique faiblesse de leur vocabulaire.
Il m’avait fallu prendre le Larousse (qui avait perdu sa couverture) pour y aller chercher ce qu’était un fucus, ces alcyons qualifiés de charmants et qui étaient stellés, ainsi que les grandes rhizostomes de Cuvier qui portaient une ombrelle…
J’avais ainsi appris que le fucus était une algue, les alcyons des oiseaux mythiques de bon présage en mer, et les rhizostomes des grandes méduses.
J’étais passé du rêve à la réalité, mais le NAUTILUS n’était peut-être pas très loin…
Il y avait bien des algues phosphorescentes et des méduses, et nous étions, dans le sillage de Jules VERNE, à faire ce voyage extraordinaire en partant à la découverte de l’Amérique.
Dans les derniers jours de notre traversée, sale et barbu comme mes petits camarades, le dos moite de transpiration collant à ma bannette, je me suis retourné sur le ventre.
Mauvaise idée, il émanait de ma couchette une telle odeur de macchabée en décomposition
que j’ai été pris d’une nausée irrépressible que je ressent encore en l’évoquant.
Quand nous sommes arrivés aux USA, un certain nombre d’autorités sont montées à bord et se sont bouché le nez, on peut les comprendre.
Sur le quai, nous avons vu arriver des semi-remorques à portes grillagées dans lesquelles nous avons embarqué, la fermeture pneumatique des portes et le départ ont été immédiats.
Transportés sans siège en direction le shipyard de PHILADELPHIE, là ou les toilettes, l’eau chaude de la douche, le savon, le rasoir, furent des préalables indispensables pour que nous puissions être propres, présentables, et admis sur le sol Américain.
Cher COUTIL, je mets en chantier de mémoire ce qui me reste de souvenir de notre séjour, aidé par des documents et des photos que j’ai retrouvées.
Bien amicalement à toi.
deVouleme.






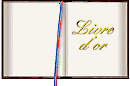





 par
par 










































